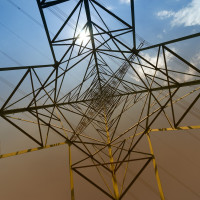À l’ère du (néo)colonialisme vert, une industrialisation verte au service de la déconnexion Pour des politiques industrielles à visage humain
Regiones
Les 8 et 9 octobre derniers, une rencontre a été organisée à Montevideo dans le cadre du programme Uruguay South Initiative, qui cherche à ouvrir un espace pour questionner les politiques industrielles vertes et la finance internationale depuis les pays du Sud. Cette rencontre a été organisée avec le soutien du ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines (MIEM), du Transnational Institute (TNI) et du bureau des Nations unies en Uruguay. Hamza Hamouchene nous fait part de certaines de ses réflexions partagées lors de ce temps d’échange.

Un débat pas si récent
Alors que l’on assiste à une résurgence des débats théoriques et politiques autour des stratégies de développement déployées dans le cadre de la transition énergétique et de la décarbonisation de l'économie, les enjeux autour des politiques industrielles vertes (PIV) font l’objet de vifs débats. Ces stratégies misent sur la (ré)industrialisation et la planification étatique, considérées comme des instruments essentiels de politique publique pour sortir de l’impasse du capitalisme périphérique.
Parmi tout le tapage auquel on assiste autour des politiques industrielles vertes (PIV) au sein de diverses instances dans les pays du Nord et du Sud (et principalement chez les premiers), notamment les décideurs politiques, les universitaires, les organisations philanthropiques et les organisations de la société civile etc., il s’avère crucial de :
- Recontextualiser les débats pour comprendre ce qui se cache derrière cette « incitation au discours », et les véritables objectifs et intérêts matériels poursuivis ;
- Rappeler aux différents acteurs et parties concernées que les échanges et débats autour de l'industrialisation ne sont pas nouveaux, et qu’ils se sont largement déployés au cours des expériences de décolonisation et de « déconnexion » dans les pays du Sud entre les années 1950 et 1970. La nouveauté peut résider dans les notions d '« écologisation » et de « décarbonisation » avancées dans le contexte de la crise climatique ;
- Il est nécessaire de considérer le risque de perpétuer le statu quo actuel, qui constitue un réel danger en termes d'inégalités à l’échelle mondiale, car ce statu quo implique le pillage des richesses par une infime minorité et l’apparition de nouvelles zones sacrificielles au nom de la durabilité.
Clarifier les termes
Lorsque j'ai lu la brève description du panel dans lequel je suis intervenu, deux points ont retenu mon attention.
Le premier concerne l'emploi du mot « compétitivité », et l’injonction formulée aux pays du Sud pour s’y soumettre. Je présume que la compétitivité ne représente pas un mal en soi, mais je pense qu'il est important de questionner la pensée dominante qui tend à considérer l'histoire par le seul prisme de la compétitivité. Dans cette optique, le retard et la pauvreté des pays du Sud ne seraient que les conséquences de leurs propres échecs ; en d’autres termes, nous avons perdu, les autres ont gagné. Mais pour reprendre les termes de l'écrivain latino-américain Eduardo Galeano : « les vainqueurs ont gagné grâce à nos défaites ». L'histoire du sous-développement en Amérique latine et dans d’autres régions du monde fait partie intégrante de l'histoire du capitalisme mondial.
Le deuxième point sur lequel je me suis arrêté, et sur lequel j’ai plus longuement réfléchi, évoque la « garantie d'une insertion souveraine dans la chaîne de valeur des matériaux et minéraux stratégiques ». Cela sonne comme une sorte d'oxymore, comme une contradiction. Comment cette insertion va-t-elle se mettre en œuvre ? Puis l’adjectif « souverain » qui tente de la qualifier. Mais alors, qui va opérer cette insertion ? Dans quel but, et pour qui ces matériaux essentiels seront-ils produits ? Là encore, les analyses formulées par Eduardo Galeano dans son livre Les veines ouvertes de l’Amérique latine s’avèrent pertinentes.
Un modèle toujours à l’œuvre
Mais alors, comment s'assurer que ce qui nous est offert par la nature n'est pas voué à l’accaparement impérialiste, et comment faire en sorte que les aspirations au patriotisme économique ne soient pas bientôt enrayées par des mécanismes néocoloniaux ?
Le leader révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara a dit un jour : « Celui qui te nourrit te contrôle ». J'ajouterais que « celui qui fabrique vos machines et produit ce que vous utilisez tous les jours peut vous asservir ». Dans le même esprit, je dirais qu'il est important de repenser l'héritage du cadre théorique formulé par l’école de la théorie de la dépendance et du système mondial, en s’inspirant notamment des réflexions d'éminents chercheurs militants, tel que le concept de « déconnexion » développé par Samir Amin.
La déconnexion
Dans le contexte d'un capitalisme monopolistique mondialisé qui se déploie au détriment des pays du Sud, l'idée que ces pays puissent « rattraper leur retard » est illusoire. Samir Amin plaide plutôt en faveur de la « déconnexion », qui promeut le développement des économies nationales pour répondre aux besoins de développement interne, et non aux exigences des entreprises et des marchés internationaux. À cet égard, la notion de « déconnexion » implique d'abolir les formes dominantes de propriété privée, de replacer l'agriculture - et la souveraineté alimentaire - au cœur des politiques économiques, d’industrialiser et de maîtriser la technologie tout en faisant barrage à l'accaparement des terres et des ressources au nom d'un « développement » axé sur l'exportation. Il ne s’agit pas de générer un isolement économique, mais plutôt de créer une rupture avec les logiques de la domination impérialiste.
Ces questions devraient faire l'objet de la plus grande attention, particulièrement dans un contexte de tensions géopolitiques et géoéconomiques croissantes qui se caractérisent par une résurgence de politiques industrielles protectionnistes, notamment dans les pays du Nord. Cette situation a été décrite par certains comme la nouvelle guerre froide « verte » entre l'Occident et la Chine, celle-ci offrant des opportunités de développement non sans risque pour les pays et les peuples du Sud. Œuvrer au renforcement d'un monde multipolaire peut ouvrir certaines perspectives aux pays du Sud qui souhaitent s’engager dans un processus de déconnexion, mais cela devrait impliquer une intégration régionale sur les plans politique et économique, et des relations Sud-Sud qui ne soient pas subordonnées à l'empire.
Soixante-dix ans après la conférence de Bandung, notre défi consiste à renouer avec les visions émancipatrices que cet événement a insufflées, et à mettre en œuvre la déconnexion (écologique) en tant que stratégie politique pour les peuples exclus et dépossédés, qui s'articule avec le pouvoir des États dans un monde qui se réchauffe. Nous devons démontrer par quels moyens une telle vision peut permettre d'élaborer et de formuler des propositions concrètes pour mettre en œuvre des alternatives justes qui contestent les pratiques extractivistes et les dynamiques néocoloniales. Ce n’est qu’en adoptant une telle approche que les populations et les pays du Sud pourront mettre un terme au cycle de la dépendance, questionner leur insertion dans l'économie mondiale dans une position subordonnée et se repositionner sur la chaîne de valeur en misant sur des politiques industrielles vertes, justes et démocratiques, et qui placent les besoins des populations au cœur des enjeux.